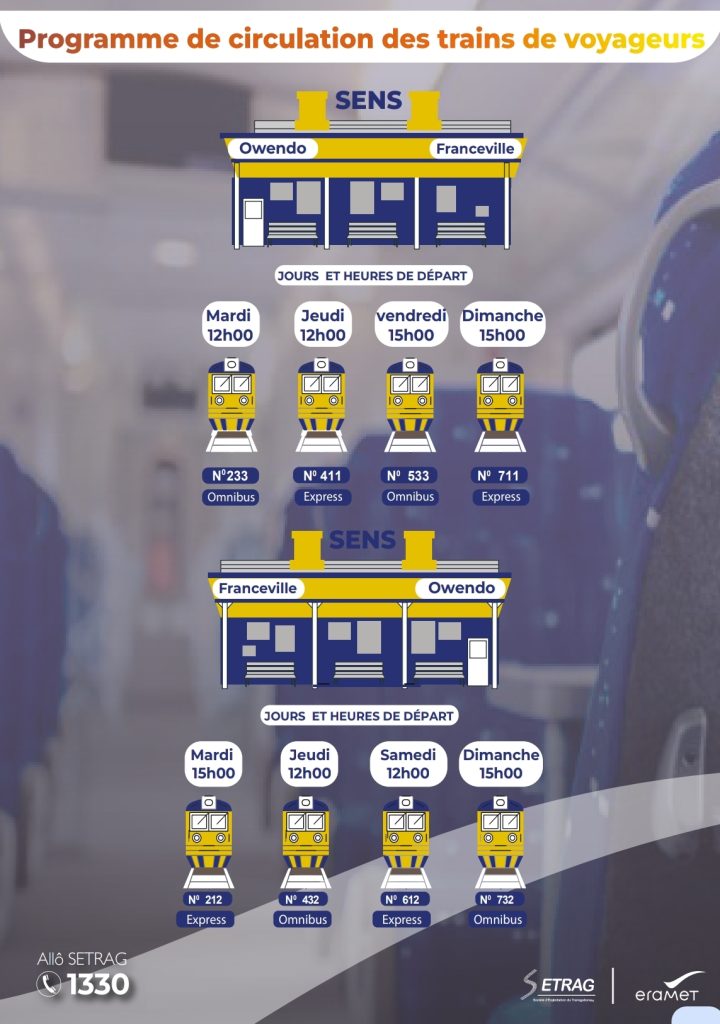Le continent africain est d’une richesse immense, du fait de sa diversité culturelle qui témoigne de la multiplicité des peuples de cet espace. Dans le même temps, l’Afrique est largement consommatrice des nouveaux moyens technologiques qui favorisent la vulgarisation des savoirs, savoir-faire et savoir-être, sou simplement de l’historicité africaine, panafricaine et afrocentriste. Cependant, il convient de noter que le lien entre cultures africaines et technologie des médias résiste mal à la critique et rend davantage difficile la notion d’héritage. Ce constat est davantage une réalité dans l’espace régionale de la CEEAC, mettant par ailleurs une en exergue une réelle crise de la notion de l’intégration dans cette espace avec pour corollaire immédiate une méconnaissance accrue de l’institution, de ses missions et objectifs.
Dès lors, trois articulations permettent de rendre claire la présente analyse : (1) l’état des lieux, entre usage de la technologie des médias et niveau de connaissance, pratique et influence des savoirs africains ou savoirs endogènes ; (2) les moyens, à travers les scientifiques africains et la vulgarisation des résultats des recherches ainsi que la coordination africaine via un agenda unanime des actions à mener, du moins pour ce qui de l’Afrique au Sud de Sahara et enfin (3) nous suggérons l’afrocentricité comme un modèle de pensée.
En ce qui concerne l’état des lieux, on note d’emblée que l’usage de la technologie des médias est de façon générale une donnée importante qui renseigne d’ailleurs sur le niveau d’implantation de cet instrument sur le continent. En effet, l’Afrique noire est très pratiquante des nouveaux moyens de communication et d’échange d’information et cela est fort perceptible à travers deux principaux indicateurs : la forte démographie jeune du continent, soit environ 77% de la population continentale et l’impressionnante et massive production au relent culturel (musique, cinéma…).
Seulement, si la technologie des médias est une réalité forte sur le continent du fait des efforts consentis par les différents Etats, cas du Gabon. « Selon une étude de la Banque mondiale, le Gabon est classé premier pays le plus connecté de l’Afrique centrale et occupe la troisième place en Afrique subsaharienne. Sur le continent, le pays est classé huitième. La première place des pays connectés en Afrique est occupée par le Maroc ». D’ailleurs, pour la banque mondiale, le Gabon « a gagné 10 places dans le classement mondial 2017 de l’indice de développement de l’internet, réalisé en novembre 2017 par l’agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication (UIT). Il est aujourd’hui le 6e pays le plus performant d’Afrique pour le secteur des TIC, après l’Île Maurice, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Cap vert et le Botswana. » Il y a lieu de noter qu’elle participe difficilement à la diffusion des savoirs africains car ce qui est renvoyé à travers ces canaux de transmission n’est majoritairement pas représentatif des cultures africaine, mais surtout une sorte d’hybridité et un folklore qui dépeint les sociétés continentales sous des traits maquillés, édulcorés et déconnectés de notre réel patrimoine.
Acerbe et corrupteur, cette vulgarité devient un facteur d’une redoutable inquiétude qui densifie davantage le fossé entre une Afrique noire en réelle crise de l’africanisme et son rapport au monde dans le concert des nations et son positionnement dans la mondialisation.
La connaissance ou l’influence des savoirs endogènes n’est que pale et d’un effet mitigé. Tel est le réel constat. L’absence d’une posture au substrat « afropertinent» échappe cruellement à la capacité de l’africain noir à donner au monde son originalité. En Afrique centrale autant qu’ailleurs, tout ou presque reste à faire, interpellant pouvoirs politiques et scientifiques devant la léthargie qui embrigade la possibilité d’érection d’un réel concept fédérateur qui fasse que se reconnaisse l’ensemble des populations « afrocentraliennes ».
A titre d’exemple, que retient-on des programmes distillés à longueur de temps sur les médias du continent : dépravation, déculturation ; acculturation, européanisation des pseudos cultures africaines, ivresse, divertissement à outrance et absence d’intellectualisme et de sciences africaines.
Dans la deuxième articulation de cette analyse, il sied de noter que les moyens de vulgarisation de la science africaine existent mais sont très sous exploités et peu diversifiés comme en témoigne Jean-François Owaye : « les savoirs conçus depuis une cinquantaine d’années ont définitivement sorti l’Afrique de son impensé scientifique voire de sa périphérisation par l’historicité coloniale et les travaux des africanistes ». Chacun dans ses analyses, avec ses mots, décrivant maux et difficultés du Continent, tente de montrer avec pertinence la justesse d’une pensée émancipée et émancipatrice pour l’Afrique. «Les Africains doivent éviter de tomber dans un piège, de plus en plus manifeste que certains d’entre eux se tendent à eux-mêmes, celui du refus du développement » disait l’ancien Secrétaire général de l’OUA Edem Kodjo en 1986. Chacune des études qui se penchent sur le devenir du Continent, présente, à des degrés divers, la nécessité de cette partie du monde d’amorcer son développement. Tous semblent s’accorder sur les potentialités d’ordre historique, culturel, climato-géographiques etc., dont la nature a très gracieusement gratifié le Continent africain.
La conséquence est dès lors que nous faisons de la science pour la science alors que la colonisation nous a enseigné que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme» (François Rabelais, 1483-1553). Les scientifiques africains, du moins un grand nombre, sont rivés vers une « extraversion » de leurs productions et recherches scientifiques et finissent par ne plus intéresser les jeunes générations qui sont l’avenir du continent.
D’autre part, les productions qui portent une réelle marque africaine sont minorées et parfois limitées aux simples barrières des laboratoires, des symposiums scientifiques, des universités. Il est donc d’une urgence irréfutable de comprendre et de reconnaître qu’il est l’heure depuis fort longtemps déjà, s’il faut s’attacher à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, pour que l’Afrique Noire puisse finalement entamer son propre développement. D’ailleurs, dans son commentaire du livre de René Dumont, Philippe Ducraene cite l’auteur : «l’Afrique intertropicale piétine. […] Elle pourrait cependant se développer rapidement. […] L’Afrique doit repenser son école, ses cadres, sa structure…- et se mettre au travail». C’est donc le lieu de saluer le combat des Afrocentristes, panafricains et activistes qui mènent aujourd’hui le combat d’une Afrique des savoirs : Kémi Séba, Natalie Yamb, Engountchi Béhenzin, Mwazulu…, le Professeur Covi Gomez dit Rekmiréh et surtout, un vibrant Hommage au très regretté Professeur Omotoundé Kalala. Il urge en effet d’avoir une réelle coordination africaine et un agenda unanime autour des actions à mener.
Cette coordination est d’abord l’affaire des scientifiques comme l’ont été dans les années 1930 et avant, les mouvements de la Négritude et du Panafricanisme. En effet, le temps des révolutions est donc désormais celui qui fait chaque jour la beauté de l’émergence d’une Novelle Pensée Africaine sous le prisme des Anciens ! Dans cette ligne d’expression, J-F. Owaye exprime qu’ « Il faudrait, sans doute, résoudre plusieurs autres équations sociologiques : la modélisation ou la conceptualisation des schémas de développement sous-tendue par des corps de sciences sociales africaines. » Le paradigme d’une entreprise africanisée de la recherche scientifique étant en effet une réalité dans un contexte où nombreux, intellectuels et incultes, homme de la rue et de confessions etc., revendiquent l’adhésion à une nouvelle Afrique. Que fait-on de la charte de la Renaissance de la culture africaine ? En effet, en son préambule, la charte de Khartoum stipule « qu’il est urgent d’édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines et les valeurs universelles afin d’assurer à la fois l’enracinement de la jeunesse dans la culture africaine et de l ‘ouvrir aux apports fécondants des autres civilisations […] dans la perspective d’un développement endogène durable ouvert sur le monde », tout en précisant aux articles 11 ; 12 et 13 la nécessité de valoriser nos savoirs endogènes. Qu’en est-il à ce jour ?
Pour finir, retenons l’afrocentricité comme outil de promotion de nos savoirs endogènes et pour un héritage africain qui sache profiter aujourd’hui des nouvelles technologies de diffusion et de vulgarisation de la culture. Dans le vif contexte de renouvellement de la présidence de la CEEAC, il importe, dans une relative exigence, de rappeler qu’outre la politique, les valeurs démocratiques, les préoccupations socio-économiques, la question de l’intégration culturelle pour la préservation des savoirs endogènes est une marque indélébile de la volonté de construire une Afrique centrale forte et active à partir d’une afrocentricité ceeacienne. Que compte donc faire Ali Bongo Ondimba face à ce chantier herculéen ? Wait and see !
Le temps de la revendication devrait donc aujourd’hui intégrer celui de l’affirmation et malgré les difficultés, nous en avons les capacités car comme le disait Franz Fanon : « chaque génération doit dans une relative opacité affronter sa mission : la remplir ou la trahir».
Par Yvan Comlan OWOULA B,Chercheur en Histoire des Relations Internationales, spécialité Paix et Sécurité en Afrique